|
Pierre Campion : « Tristes tropiques » de Lévi-Strauss.
Cet article est paru dans Les Temps modernes de novembre-décembre 2017 n° 696. © : Pierre Campion.
Tristes tropiques de Lévi-StraussÀ la recherche du sens perduEn 1955, dédié par l'auteur à son fils Laurent alors âgé de huit ans et sous un exergue de Lucrèce qui évoque l'histoire comme la chute des siècles les uns après les autres[1], — pièces et morceaux jetés dans l'urgence à la face du public et de collègues mal disposés à son égard, le livre de Lévi-Strauss développe pourtant un mouvement unique de réflexions, de pensées et de styles. Soliloque puissant, varié de formes et cohérent d'inspiration, dérivant entre les âges de l'écrivain au gré des choix et des paradoxes de sa mémoire, c'est le tracé quelque peu tremblé d'une vie entre les années d'enfance et l'automne de 1954, quand se prépare la guerre d'Algérie (l'auteur ne le sait pas encore) et que les derniers liens avec Ç [son] passé idéologique et politique È se défont : il le sent, et il s'en inquiète. Plus anecdotique mais significative, il y a aussi cette obsession inavouée : aurait-il manqué quelque chose dans sa carrière pour que, à quarante-six ans, savant reconnu dans la sphère américaine de l'ethnologie et méconnu dans les cercles de la science française, il ait déjà été recalé deux fois au Collège de France ? Plus profondément, sur le fond de deux questions récurrentes — pourquoi s'en aller au loin et comment en revenir ? —, il se demande quelle erreur, quelle faute, où et quand commise, grève sa vie. Tristes tropiques, c'est Ç les confessions de Claude Lévi-Strauss[2]. È Tout le livre va être fait de retours en arrière et d'ellipses, de repentirs et traverses, de remises en questions, qui viennent troubler l'ordre chronologique des événements, l'effort d'unification de la narration, et le fil de la lecture. Sur ce trouble, commençons l'enquête au plus près de nous, c'est-à-dire plus de trente ans après la publication de Tristes tropiques, quand Lévi-Strauss revient sur son livre et sur un certain regret. Se déprendre de l'HistoireEn 1988, à l'approche de ses quatre-vingts ans, Claude Lévi-Strauss s'entretient avec Didier Éribon. Voici qu'ils évoquent mai 68 (vingt ans déjà, mais toujours un marqueur dans la politique et dans les vies !), et que Lévi-Strauss dit crûment : Ç Une fois passé le premier moment de curiosité, une fois lassé de quelques drôleries, mai 68 m'a répugné[3]. È D. E. : Cette hostilité à mai 68 n'était-elle pas une rupture totale avec vos engagements de jeunesse ? C. L.-S. : Si je veux rechercher les traces de cette rupture, je les trouve beaucoup plus tôt, dans les dernières pages de Tristes tropiques. Je me souviens m'être évertué à maintenir un lien avec mon passé idéologique et politique. Quand je relis ces pages, il me semble qu'elles sonnent faux. La rupture était consommée depuis longtemps. Ici Lévi-Strauss vise probablement le passage de son livre où il rapprochait le marxisme du bouddhisme : Ç Entre la critique marxiste qui affranchit l'homme de ses premières chaînes — lui enseignant que le sens apparent de sa condition s'évanouit dès qu'il accepte d'élargir l'objet qu'il considère — et la critique bouddhiste qui achève la libération, il n'y a ni opposition ni contradiction. Chacune fait la même chose que l'autre à un niveau différent[4]. È Certainement, l'idée même de lier ces deux Ç critiques È de l'apparence et l'ordre dans lequel la plus ancienne est censée achever l'autre, tout cela était tout à fait acrobatique. Pourquoi ce dispositif qui sent l'effort de l'équilibriste ? Peut-être faut-il y voir en effet le scrupule d'un homme qui avait été marxiste de formation et socialiste d'obédience, et qui peinait à se détacher de ses engagements. Peut-être aussi le souci de ne pas sortir d'un certain malentendu. Car, depuis 1949, Lévi-Strauss était accueilli dans Les Temps modernes. Sous le titre Ç Des Indiens et leur ethnographe È, il y publiera en 1954 des bonnes feuilles du Tristes tropiques à paraître. Entre-temps, il a eu, de la part de Beauvoir, un compte rendu très favorable pour ses Structures élémentaires de la parenté puis, en 1956, il va y lire un article, très perspicace à ses yeux, de Jean Pouillon sur Ç L'œuvre de Lévi-Strauss[5] È. Jusque dans ces années 1950, la revue de Sartre, et Sartre lui-même sans doute, traitent Lévi-Strauss sinon comme un membre de leur famille du moins comme une personnalité tout naturellement et naïvement supposée progressiste. Et puis, vers 1955, rompre avec le marxisme, c'était quitter l'Histoire. Sartre, justement, s'y refusait et, pour sauver le communisme, il écrivait la longue suite, embarrassée et inachevée, des Communistes et la paix. Lévi-Strauss avait été marxiste bien avant que ses contemporains, Sartre, Beauvoir ou Merleau-Ponty, se fussent avisés de lire Marx, et de frayer ou de s'empoigner avec le Parti communiste français. Il avait été cet adolescent initié au marxisme par un socialiste belge, puis ce militant qu'il évoque justement au début de Tristes tropiques, responsable de cercles étudiants et candidat de la SFIO à une élection locale. Sans doute ses nouveaux amis n'avaient-ils pas saisi que tout le livre de Tristes tropiques démentait ce passé-là — et peut-être l'auteur ne souhaitait-il pas assumer jusqu'au bout ce démenti. Rupture donc dans cette vie, beaucoup plus haut qu'en 1968 : en 1955. Et bien plus haut qu'en 1955… Alors où et quand, et comment ? Regardons le livre et ce qui paraît d'abord comme un désordre. Ç Proust bien sûr È ?Tristes tropiques est l'histoire d'un homme qui dispose dans sa mémoire, à la première personne et au gré d'un arbitraire apparent, les épisodes de son expérience : les traversées de l'Océan, les paysages qu'il a vus, les deux tropiques désenchantés de sa planète imaginaire et les peuples qu'il y a visités, les critiques de la philosophie française et les réflexions qu'il s'est faites, sa vision du monde… Ce sol mental où s'est déposé par couches le sens du monde et qui se déroule sous Ç le tapis volant È (ch. XIV) de sa libre fantaisie, cette conscience d'une vocation, cette sensibilité aux moindres sollicitations de son univers, l'unité puissante de cette vision, tout cela pourrait bien avoir à voir — transposé, réfléchi et presque méconnaissable — avec une certaine lecture, celle de la Recherche du temps perdu[6]. Comme dans Proust, le sujet de la narration est omniprésent et jamais identifié autrement que par son Je, sa parole et son style ; il est à la fois labile et solide, et il revêt une espèce de souveraineté. Pas plus que chez Proust, il n'est le moi de l'individu, le moi qui sera évoqué, à la fin du livre, pour être révoqué, non seulement comme haïssable mais comme n'ayant Ç pas de place entre un nous et un rien È (p. 496). Comme dans l'univers totalisé du Temps perdu, l'analyse peut entrer dans celui de Tristes tropiques par le point que l'on veut : entrons par le côté des Nambikwara. Chez les Nambikwara, le retour du refoulé…La partie IX de Tristes tropiques comporte quatre chapitres, dont d'abord celui de Ç L'apothéose d'Auguste È. Ce moment-là nous ramène en arrière, à la couche mémorielle de la partie VII consacrée déjà aux Nambikwara. Dans des circonstances éprouvantes de solitude, de désœuvrement et d'acédie comme en connaissent les ermites retirés au désert, l'ethnographe s'abandonne à l'obsession étrange d'un morceau de Chopin — une musique pourtant qui n'a jamais eu ses faveurs. Et puis il s'adonne à la tentation d'écrire un remake du Cinna de Corneille. Autrefois, Auguste avait choisi d'agir sur place, à Rome ; Cinna, son ami, avait préféré s'en aller chez les sauvages, dans l'intention d'en revenir paré des prestiges de l'Ailleurs et de se procurer, par ce détour, et l'amour d'Émilie et le pouvoir suprême qu'Auguste occupe désormais. Les deux amis sont déçus, l'empereur parce qu'il découvre la vanité du statut divin que lui préparent ses affidés et comparses, et Cinna parce qu'il mesure le peu qu'il a appris chez des peuples déshérités, l'imposture des succès qu'il en retire à Rome et la disproportion entre les sacrifices ainsi consentis et les profits réels de cette aventure. Cela devait mal finir, suggère l'ethnographe, qui ne s'est pas donné la peine d'achever sa pièce. L'apologue est transparent. Pourquoi partir au loin s'il n'y a rien à savoir là-bas et rien à en retirer ici, en tout cas rien de plus que si on était resté aux lieux de l'action effective[7] ? La question est sérieuse, et Roger Caillois la posa de son côté, à l'endroit de Lévi-Strauss, avec obstination et jusque dans le discours qu'il fit pour recevoir l'ethnologue à l'Académie française, en 1974 : pourquoi ces voyages excentriques, si c'est pour solliciter et obtenir d'être adopté un jour par la mère Académie ? Lorsque vous remontiez les fleuves impassibles pour vous interner dans la moiteur de ces tropiques dont vous avez dit la tristesse, vous ne vous attendiez pas, du moins je le présume, à siéger un jour parmi nous en ce costume non moins chargé d'ornements que de peintures et de tatouages les corps des Indiens que vous vous appliquiez à mieux connaître et de qui vous avez eu l'humilité de déclarer recevoir des leçons — l'humilité ou peut-être la secrète satisfaction d'en donner une, par ce biais, à vos auditeurs[8]. Et tout à l'avenant, d'ironie perspicace, de malveillance et de froide rancune au souvenir des polémiques passées[9]… … Puis sur le chemin qui mène aux États-UnisDans le chapitre suivant de Tristes tropiques, Ç Un petit verre de rhum È, juste après cette fable tirée de son fonds de classicisme, Lévi-Strauss revient sur le voyage de 1941, déjà raconté dans les premières pages (ch. II, Ç En bateau È), qui le conduisait par la Martinique vers l'exil des États-Unis. Désormais il évoque explicitement Ç les contradictions de l'ethnographe È et il s'y arrête longuement. Dans le mouvement premier de 1935, qui l'avait transporté au Brésil, il y avait le refus de l'ici. Quitter un monde où tout est vanité : l'exercice du pouvoir, l'exercice de l'enseignement, celui même de la pensée, où il n'y a plus rien à inventer, où une intelligence néolithique ne trouve plus rien à brûler… C'était le mouvement d'une vocation, c'est-à-dire d'un appel venu en fait du fond de soi-même, contre les dégoûts du monde, en faveur d'une science inconnue : Ç […] l'ethnographie est une des rares vocations authentiques. On peut la découvrir en soi, même sans qu'on vous l'ait enseignée È (p. 57). Tout cela avait été parfaitement exprimé dès le chapitre VI, Ç Comment on devient ethnographe È. Or voici que se développe, peu après la fin de l'aventure brésilienne, un premier doute sur la pureté de ces intentions, un premier examen de conscience. D'abord ceci, en effet. Pour échapper à la fétichisation naïve des sociétés sauvages vers lesquelles le portait cette vocation, l'ethnographe doit se convertir à un certain relativisme : On découvre alors qu'aucune société n'est foncièrement bonne ; mais aucune n'est absolument mauvaise. Toutes offrent certains avantages à leurs membres, compte tenu d'un résidu d'iniquité dont l'importance paraît approximativement constante et qui correspond peut-être à une inertie spécifique qui s'oppose, sur le plan de la vie sociale, aux efforts d'organisation. (p. 463) Ç Adieu sauvages, adieu voyages ! È (p. 497), et déjà le principe d'inertie. Voilà ce que l'on apprend en goûtant le rhum de la Martinique — le petit verre du condamné ? —, dont la saveur tient justement à ses impuretés… Autre question, qui minait déjà ses Cinna et Auguste nouvelle manière : qu'est-ce qu'agir dans la société occidentale ? Pure et vaine agitation, semble-t-il, quand l'homme d'action découvre qu'il n'existe pas Ç un terme absolu où il trouve à la fois sa récompense et son repos È (p. 456). Telle était déjà la découverte d'Auguste dans Corneille, avant que, prenant sur lui-même, l'empereur ne se reprenne… Mais alors comment ne pas tomber dans le Ç c'était bien la peine… È, le Ç tout se vaut È, et l'à quoi bon, dont ensemble le bon sens trivial, le relativisme savant, et l'esprit de la démission sont coutumiers ? Ç Rousseau, notre maître, Rousseau, notre frère… ÈC'est le moment de rendre grâces à quelqu'un, qui, n'étant jamais allé sur le terrain, savait pourtant déjà ce qu'il en est du sens dans les sociétés et de la manière de changer la sienne, si possible : En agitant ces problèmes, je me convaincs qu'ils n'admettent pas de réponse, sinon celle que Rousseau leur a donnée : Rousseau tant décrié, plus mal connu qu'il ne le fut jamais, en butte à l'accusation ridicule qui lui attribue une glorification de l'état de nature — où l'on peut voir l'erreur de Diderot mais non pas la sienne —, car il a dit exactement le contraire et reste seul à montrer comment sortir des contradictions où nous errons à la traîne de ses adversaires. […] Rousseau, notre maître, Rousseau, notre frère, envers qui nous avons montré tant d'ingratitude, mais à qui chaque page de ce livre aurait pu être dédiée si l'hommage n'eût pas été indigne de sa grande mémoire. (p. 467) Page d'éloquence et de poésie, page à proposer en thème latin — il en est beaucoup dans ce livre —, où éclate le paradoxe d'une maîtrise philosophique, celle de Rousseau, mais exercée de manière fraternelle, — selon une fraternité, dont pour le moment nous ne savons pas encore l'ascendance paternelle. Car, de la contradiction inhérente à la position de l'ethnographe, nous ne sortirons jamais qu'en répétant pour notre compte la démarche qui l'a fait passer, des ruines laissées par le Discours sur l'origine de l'inégalité, à l'ample construction du Contrat social dont l'Émile révèle le secret. À lui, nous devons de savoir comment, après avoir anéanti tous les ordres, on peut encore découvrir les principes qui permettent d'en édifier un nouveau. (p. 467-468) En effet, que nous suggère l'invocation à Rousseau ? D'abord : il n'existe d'homme naturel et de société innocente autrement que par une hypothèse de la pensée. Puis ceci : cet objet purement heuristique qu'est l'état de nature est le modèle opérationnel selon lequel nous pouvons à la fois penser toutes les sociétés, les critiquer chacune et envisager la transformation de la nôtre, laquelle est la seule que nous ayons, dans laquelle nous vivions et que nous devions amender : L'étude de ces sauvages apporte autre chose que la révélation d'un état de nature utopique, ou la découverte de la société parfaite au cœur des forêts ; elle nous aide à bâtir un modèle théorique de la société humaine, qui ne correspond à aucune réalité observable, mais à l'aide duquel nous parviendrons à démêler Ç ce qu'il y a d'originel et d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme et à bien connaître un état qui n'existe plus, qui peut-être n'a point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent È. (p. 469) Pensée politique s'il en est, mais d'une politique spéculative et théorique : Rousseau, et non pas Marx ! L'Asie, notre mère : une méditation métaphysiqueEnvisagé dans sa totalité et contre toute autre logique que celle de l'Esprit et de ses ruses, le retour du Brésil passait donc par l'examen critique de l'aller : par Chopin et Corneille, par la Martinique, par Rousseau, puis, selon une ellipse énorme et engagée dès la partie IV, Ç La terre et les hommes È, par Karachi, par le site archéologique de Taxila en Inde et sur la frontière birmane du premier Pakistan. Sur son prodigieux tapis volant, la pensée de l'ethnographe, enfin libérée de ses attaches mondaines, survole le Monde tel que s'en est déposée tout naturellement la mémoire dans les plis et replis de son être. Et que voit-il, dans l'examen de lui-même, et pour ainsi dire souverainement ? D'abord les trois grands systèmes symboliques des religions qui se partagent notre univers physique, intellectuel et spirituel, d'Ouest en Est : le christianisme, l'Islam et le bouddhisme. Ce sont des pages étonnantes, écrites au moment où, à l'instant où se déclenche la guerre d'Algérie, la politique française s'interroge encore sur le statut des musulmans du Maghreb, au cas où on voudrait les considérer comme citoyens français de plein droit. Mais, nonobstant cette réflexion sur Ç une France musulmane È, dont l'une des rares notes de bas de page est venue relever le caractère désormais anachronique, Lévi-Strauss développe une géographie mentale et philosophique selon laquelle l'Islam est venu tardivement redoubler les premières religions du Livre, disjoindre l'Occident de l'Orient et empêcher, par sa position médiane et sa surenchère en Ç cette conviction obstinée qu'il suffit de trancher les problèmes sur le papier pour en être débarrassé aussitôt È (p. 485), un rapprochement qui aurait pu — qui aurait dû ? — avoir lieu. Et puis, passé sous l'autre des deux tropiques, notre visionnaire contemple maintenant une humanité submergée par la masse de son propre poids, une dégradation qui fait pendant à la solitude des tribus en perdition dans le Mato Grosso. N'était, au bord de la frontière birmane, un temple bouddhiste de campagne, un certain kyong, on pourrait croire oubliée à jamais l'antique sagesse du Bouddha. Se rappelant alors et à propos la visite qu'il fit à ce kyong en septembre 1950, l'ethnographe évoque cette sagesse et ce qu'il avait appelé plus haut Ç la grandeur indéfinissable des commencements È (p. 471). Ces commencements-là, assurément ce ne sont pas ceux des matins révolutionnaires, 1789, 1871 ou 1917. Dans les rêveries du voyageur solitaire, voici en effet qu'apparaît une notion d'ingénieur inattendue, celle de l'entropie. Selon cette intuition, la première réflexion de l'humanité est la bonne et elle périme d'avance toutes les autres. Avant les raisonnements de l'Occident et ses dialectiques pesantes, le sage sous l'arbre avait d'emblée pensé les contradictions entre savoir et non-savoir, agir et non-agir, dispersé l'idée de divinité entre tous objets et choses du monde, compris que tout échange entre celui qui sait et celui qui ne sait pas abaisse le niveau du savoir. Selon une anthropologie bien conduite, c'est-à-dire dissoute en une Ç entropologie È (p. 496), la faute personnelle de l'ethnographe se dissout sans se perdre dans la fatalité d'une histoire de l'humanité comprise comme la succession des pertes en énergie, en vérité et en valeur, qui surviennent à chaque fois qu'elle change de système de pensée. Cependant, seul entre tous les savoirs de la pensée occidentale, celui de l'ethnographe a au moins le mérite de le déporter aux divers points du monde où il aperçoit que ces savoirs s'annulent les uns les autres dans leur prolifération. Cette découverte ne l'empêche pas de travailler à la connaissance, mais comme quelqu'un qui sait maintenant le cercle complet dans lequel se dissipe chaque savoir, c'est-à-dire dans lequel chacun, par son abolition même en un autre, prend son sens, réel mais dégradé et dégradant : En tant qu'ethnographe, je cesse alors d'être seul à souffrir d'une contradiction qui est celle de l'humanité tout entière et qui porte en soi sa raison. La contradiction demeure seulement quand j'isole les extrêmes : à quoi sert d'agir, si la pensée qui guide l'action conduit à la découverte de l'absence de sens ? Mais cette découverte n'est pas immédiatement accessible : il faut que je la pense, et je ne puis la penser d'un seul coup. Que les étapes soient douze comme dans la Boddhi, qu'elles soient plus nombreuses ou qu'elles le soient moins, elles existent toutes ensemble et, pour parvenir jusqu'au terme, je suis perpétuellement appelé à vivre des situations dont chacune exige quelque chose de moi : je me dois aux hommes comme je me dois à la connaissance. L'histoire, la politique, l'univers économique et social, le monde physique et le ciel même m'entourent de cercles concentriques dont je ne puis m'évader par la pensée sans concéder à chacun une parcelle de ma personne. Comme le caillou frappant une onde dont il annelle la surface en la traversant, pour atteindre le fond il faut d'abord que je me jette à l'eau. (p. 495) La faute, s'il en est une, réside dans la contradiction inhérente à la pensée humaine, dans la contradiction entre l'absence de sens et l'exigence qu'il y a ait du sens. L'ethnographe ne fait que la prendre sur lui. Nouvelle vie, nouveaux devoirs… Se faire caillou et se jeter de soi-même à l'eau, traverser d'un trait de pesanteur mais une par une toutes les connaissances, payer de sa personne en la neutralisant, écrire ce livre comme un geste désespéré à l'égard de ceux qui croient savoir… Ainsi se trouve sauvé l'ethnographe, ainsi découvre-t-il par sa voie à lui et en son intérieur le sens perdu du Monde, et par son écriture poétique — par ses métaphores, par le mouvement impétueux et imprévisible de ses développements, par son style d'humanité — éprouve-t-il la perte du Sens. Car au moins l'ethnologie, par son appel obscur et impérieux, aura-t-elle enlevé à l'Occident l'homme déçu par la vie et la philosophie à l'occidentale. Chez les Nambikwara dénués de tout, elle lui aura même permis un moment de la pitié humaine : Ç […] Le visiteur qui, pour la première fois, campe dans la brousse avec les Indiens, se sent pris d'angoisse et de pitié devant le spectacle de cette humanité si totalement démunie ; écrasée, semble-t-il, contre le sol d'une terre hostile par quelque implacable cataclysme ; nue, grelottante auprès des feux vacillants. […] Mais cette misère est animée de chuchotements et de rires. Les couples s'étreignent comme dans la nostalgie d'une unité perdue. È (p. 345-346) […] J'avais cherché une société réduite à sa plus simple expression. Celle des Nambikwara l'était au point que j'y trouvai seulement des hommes. (p. 377) Dans cette page arrachée à un carnet de terrain, et qu'il faudrait citer en entier, frémit la voix impersonnelle de l'humanité perdue. Cependant on y entend encore probablement l'écho de la description du prolétaire selon Marx, sinon même l'adresse de Mallarmé aux terrassiers du chemin de fer abîmés au sol, à l'écoute de la terre mère : chacun sous son petit nom ou sous le surnom de sa province, ivres morts, le dimanche soir. En somme, le seul savoir qui permette à la science occidentale d'atteindre à la haute idée du non-savoir, c'est l'ethnologie, parce qu'elle constitue le détour nécessaire à cet accès et non pas une triste réflexion de gros bon sens. Et la seule écriture qui soit celle du temps retrouvé, c'est l'ethnographie. Car l'écart entre le lointain et le proche, avec les épreuves y compris physiques qu'il suppose, porte la question du sens et le clivage dans l'ethnographe lui-même, jusqu'à le rendre impersonnel : Pourtant j'existe. Non point, certes, comme individu ; car que suis-je sous ce rapport sinon l'enjeu à chaque instant remis en cause de la lutte entre une autre société, formée de quelques milliards de cellules nerveuses abritées sous la termitière du crâne, et mon corps qui lui sert de robot ? […] Le moi n'est pas seulement haïssable : il n'a pas de place entre un nous et un rien. Et si c'est pour ce nous que finalement j'opte, bien qu'il se réduise à une apparence, c'est qu'à moins de me détruire — acte qui supprimerait les conditions de l'option — je n'ai qu'un choix possible entre cette apparence et rien. (p. 496-497) Méditation et pari, pascaliens cette fois : à ce prix-là, d'un acquiescement à une apparence d'humanité plutôt qu'au rien, on se sauve de la tentation du nihilisme et du péché de suicide… Cependant, souvenons-nous, celui qui dit cela, le Ç Je È impérial du style, le Je proustien de cette narration et de cette méditation, domine toutes ses antinomies, à l'altitude où il se déplace en lui-même, très haut : plus haut qu'elles, en les écrivant. Dans le style de Lévi-Strauss : Ç la sombre beauté È des finalsPassé la tentative étrange, et plus tard désavouée, de dialectiser le marxisme par le bouddhisme pour sauver celui-là par celui-ci, passé donc le temps où il croyait encore à l'Histoire, l'écrivain est prêt pour la grande prose poétique et éloquente de la dernière page, qu'il faudrait reprendre tout entière : pour cette espèce de prose, qui n'est pas celle de Proust, mais plutôt celle de Chateaubriand, et bien plus haut encore celle de Bossuet et de Tite-Live, pour une sorte de Ç Discours de la déprise È qui exalte par anaphores et métaphores, non sans une certaine ironie peut-être, la seule faveur qui nous soit réservée, Ç tant que nous serons là et qu'il y aura un monde È… […] l'unique faveur […] ; cette faveur […] ; chance, vitale pour la vie, de se déprendre et qui consiste — adieu sauvages ! adieu voyages ! — pendant les brefs intervalles où notre espèce supporte d'interrompre son labeur de ruche, à saisir l'essence de ce qu'elle fut et continue d'être, en deçà de la pensée et au delà de la société : dans la contemplation d'un minéral plus beau que toutes nos œuvres ; dans le parfum, plus savant que nos livres, respiré au creux d'un lis ; ou dans le clin d'œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque, qu'une entente involontaire permet parfois d'échanger avec un chat. Plus tard, en 1971, il y eut un autre final, ouvertement métaphysique — non pas philosophique — et de grand style encore, l'une de Ç ces proses de sagesse mortelle[10] È qui bouleversent le poète Michel Deguy : la dernière page de L'Homme nu, laquelle venait clore la série des quatre volumes des Mythologiques[11]. Au terme d'un travail colossal, surgit ici une autre antinomie que celle du nous ou rien mais plus radicale encore : entre être et non-être, à assumer. Pour vivre une vie pleinement humaine, il faut penser et vivre les deux. Réalité de l'être, que l'homme éprouve au plus profond de lui-même comme seule capable de donner raison et sens à ses gestes quotidiens, à sa vie morale et sentimentale, à ses choix politiques, à son engagement dans le monde social et naturel, à ses entreprises pratiques et à ses conquêtes scientifiques ; mais en même temps, réalité du non-être dont l'intuition accompagne indissolublement l'autre puisqu'il incombe à l'homme de vivre et lutter, penser et croire, garder surtout courage, sans que jamais le quitte la certitude adverse qu'il n'était pas présent autrefois sur la terre et qu'il ne le sera pas toujours, et qu'avec sa disparition inéluctable de la surface d'une planète elle aussi vouée à la mort, ses labeurs, ses peines, ses joies, ses espoirs et ses œuvres deviendrons comme s'ils n'avaient pas existé, nulle conscience n'étant plus là pour préserver fût-ce le souvenir de ces mouvements éphémères sauf, par quelques traits vite effacés d'un monde au visage désormais impassible, le constat abrogé qu'ils eurent lieu c'est-à-dire rien. En termes plus familiers, vers ses quatre-vingts ans, voici la réponse que fit l'auteur d'une œuvre immense à la question du devenir de cette œuvre, posée encore par Didier Éribon[12] : D. E. : La perspective d'être dépassé, voire oublié, cela ne vous révolte pas ? C. L.-S. : Ce serait de l'enfantillage. Des siècles d'histoire des idées démontrent que c'est le sort commun. D. E. : Mais avoir fait tant de travail… C. L.-S. : Pourquoi ai-je tant travaillé ? Quand je travaille, je vis des moments d'angoisse, mais quand je ne travaille pas, j'éprouve un morne ennui et ma conscience me taraude. La vie de travail n'est pas plus gaie que l'autre, mais au moins on ne sent pas le temps passer. Désormais la faute est complètement identifiée et le remède, s'il en est, indiqué, sans illusions. Le mal consiste à exister dans le Temps et la forme sous laquelle il tourmente le sujet est l'ennui : comment occuper le temps sinon par le travail ? Celui qui, par aberration, allait au bout du monde chercher le salut trouvera modestement une espèce de réconfort dans les bibliothèques et dans son bureau parisien, à Ç s'occuper È. Comme disait le Turc de Voltaire, Ç le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin È. Le vice et le besoin n'ont pas l'air de tourmenter Lévi-Strauss ; l'ennui si, qui est le mal de la conscience, installé en elle d'origine et la minant, — l'ennui comme étant le l'affect d'un humain plongé dans le vide du Temps. Alors, comme Candide, l'ethnographe cultive son jardin, celui où il recueille les produits de l'esprit humain avec le souci d'un herboriste que l'angoisse tenaille de n'en oublier aucun, et de les ordonner tous et chacun selon leurs variétés et leurs infinies variations. Car qu'est-ce que travailler sinon écrire cette œuvre interminable qui consiste à inventorier les productions imaginatives de l'humanité, à les nommer, à les classer, à les recouper les unes les autres, à essayer ainsi de les sauver du non-sens ? Cinq ans après cet entretien, Lévi-Strauss publiait son dernier livre, son Regarder écouter lire, à la gloire des œuvres de l'art, et dont la fin pouvait choquer une fois de plus, tempérée pourtant qu'elle est par un point de vue quand même moins sidéral…[13] : Vues à l'échelle des millénaires, les passions humaines se confondent. Le temps n'ajoute ni ne retire rien aux amours et aux haines éprouvés par le hommes, à leurs engagements, à leurs luttes et à leurs espoirs : jadis et aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes. Supprimer au hasard dix ou vingt siècles d'histoire n'affecterait pas de façon sensible notre connaissance de la nature humaine. La seule perte irremplaçable serait celle des œuvres d'art que ces siècles auraient vu naître. Car les hommes ne diffèrent, et même n'existent, que par leurs œuvres. Comme la statue de bois qui accoucha d'un arbre, elles seules apportent l'évidence qu'au cours des temps, parmi les hommes, quelque chose s'est réellement passé. La faute qui tourmente Lévi-Strauss depuis le début n'était pas la sienne en propre, ni non plus un péché originel, ni même une faute. Elle est le sort d'une humanité en manque d'Histoire, dans laquelle il ne se passe rien, au fil des générations, que par les œuvres de la pensée, sauvage ou savante. En tant qu'un homme entre les hommes, dans l'esprit de fraternité puisé dans Rousseau et éprouvé chez les Nambikwara, il lui convient de confesser ce manque consubstantiel et, autant que possible, de le rémunérer : par le recueil intelligent des créations humaines. Comment ne pas se sentir coupable de ne pas y travailler ? Alors en effet, l'ethnographe serait vraiment en faute, cette fois professionnellement et moralement, pour manquement aux devoirs de sa charge et à la solidarité humaine. Pierre Campion [1] Quand il sera grand, Laurent Lévi-Strauss pourra lire cette adresse du poète latin à lui-même comme à tout homme : Ç Nec minus ergo ante haec quam tu cecidere, cadentque [les générations qui t'ont précédé ont déjà succombé, de même succomberont celles qui viendront après toi, trad. Ernout]. È [2] Dans la belle biographie d'Emmanuelle Loyer, Lévi-Strauss, Paris, Flammarion, 2015, sur l'épisode de Tristes tropiques, sur l'état d'esprit de son auteur et la réception du livre, lire notamment le chapitre 15, Ç Les confessions de Claude Lévi-Strauss È. Comme étude exhaustive, lire la notice consacrée à Tristes tropiques par Vincent Debaene, dans Claude Lévi-Strauss, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. de la Pléiade, 2008, p. 1675-1721. [3] Claude Lévi-Strauss et Didier Éribon, De près et de loin, Paris, Odile Jacob, 1988, p. 116. [4] Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, [Paris, Plon, coll. Terre humaine, 1955], édition de poche Presses Pocket, p. 494. Je renverrai désormais directement à cette édition. [5] Sur les rapports entre Lévi-Strauss et Les Temps modernes, lire Boris Wiseman, Ç Lévi-Strauss et Les Temps Modernes È, dans Les Temps Modernes, 2004/3 (n° 628), n° spécial Ç Claude Lévi-Strauss È, p. 19-23. Voir aussi Frédéric Keck, Ç Beauvoir lectrice de Lévi-Strauss. Les relations hommes/femmes entre existentialisme et structuralisme È, dans Les Temps Modernes, 2008/1 (n° 647-648), p. 242-245. [6] Les écrivains préférés de Lévi-Strauss, qu'il énumère à Didier Éribon : Ç Conrad ; Balzac, Chateaubriand… Proust bien sûr. Et Rousseau È, Claude Lévi-Strauss et Didier Éribon, ouvr. cité, p. 230. Vincent Debaene, ouvr. cité, p. XXIX, évoque Ç l'imprégnation È de Proust dans l'œuvre de Lévi-Strauss, Ç tant son influence est grande, perceptible non seulement dans le choix des épigraphes ou des titres de chapitres mais dans la composition même des ouvrages È. Plus loin, dans la notice déjà citée, il consacre plusieurs pages à analyser l'influence de Proust sur Tristes tropiques. [7] La question des vains prestiges que l'on retire des voyages au loin a déjà été posée dès le chapitre IV, Ç La quête du pouvoir È, à l'occasion d'un autre voyage, peu raconté en lui-même, celui qui, en 1938, ramenait l'ethnologue de Marseille au Brésil après le temps qu'il avait passé à Paris à la préparation de l'expédition chez les Nambikwara. [8] Consulter ce discours de Roger Caillois sur le site de l'Académie française. [9] Au printemps de 1955, dans Les Temps modernes justement, Lévi-Strauss ferraillait durement avec Caillois, sur la valeur respective des sociétés. [10] Michel Deguy, Ç Anthropologie et poésie È, dans le n° spécial de Critique, Ç Claude Lévi-Strauss È, janvier-février 1999. Il précise : Ç La beauté, somptueuse, de ces finales, la sombre beauté de ces apartés sont celles d'une sagesse classique. Sa grammaire, son phrasé, son eurythmie, son emportement souverain, son froid mépris et son discernement implacable dans les plis de l'éloquence claire, son respect rigoureux des grands partages classiques […] lui font contester la littérature et l'esthétique modernes […], et au passage les prétentions vaniteuses de la poésie. Cependant nous les lisons comme un grand texte, comme un immense poème en prose qui a la beauté du sens, la musique du sens. È On ne saurait mieux dire Ç la tristesse majestueuse È qui hante l'opéra de la pensée dans Lévi-Strauss. [11] Sur la réception de L'Homme nu et les polémiques que ce livre suscita, voir Emmanuelle Loyer, ouvr. cité, p. 571-575. [12] Claude Lévi-Strauss et Didier Éribon, ouvr. cité, p. 136. [13] Claude Lévi-Strauss, Regarder écouter lire, Paris, Plon, 1993, p. 176. Ç Une esthétique sauvage ? È, la question est d'Emmanuelle Loyer, ouvr. cité, p. 722. |
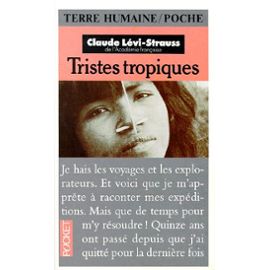 Édition : Terre humaine/Poche, Presses Pocket.
Édition : Terre humaine/Poche, Presses Pocket.