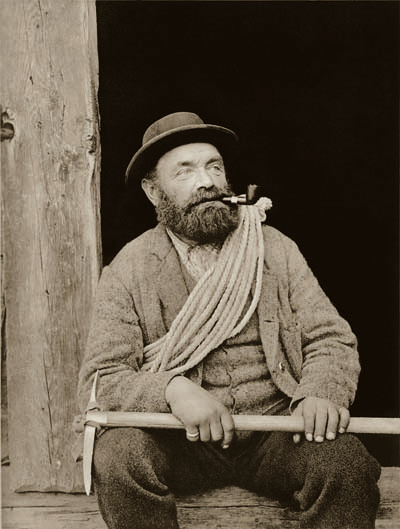LA PHOTOGÉNIE DE LA MONTAGNE
Critique d'une notion reçue
Pierre-Henry Frangne, Michel Jullien,
Philippe Poncet : Alpinisme et photographie 1860-1940, Paris, Les Éditions de l'Amateur, 2006, 248 pages,
nombreuses photographies.
Déballons ce paquet lourd et solide, prenons en mains ce livre
d'un déjà grand format — ce pan de matière —, et
considérons d'abord la jaquette de la couverture : cette image que nous
n'oublierons pas de sitôt, cette masse verticale de rocher puissamment nervurée,
nettement échancrée vers le haut et à peine rattachée par le bas, vers la
droite, à son massif d'origine, au bord de laquelle presque tout juste, et
encore proche du sommet, s'enlève à contre-jour et descend, ne tenant qu'à un
fil par ses deux mains et par le coup de reins et les deux pieds comme pris
dans la masse, un petit personnage à béret, cependant que s'inscrivent, dans ce
bloc de rocher et en blanc brillant, les lettres du titre,
— verticalement les unes (alpinisme)
et horizontalement les autres, celles-ci suivant deux lignes, et trois tailles
de caractères (et photographie 1860-1940) —, ainsi que, dans
l'air gris, à gauche et en haut, les noms des trois auteurs, en noir et en plus
petites capitales. Au dos du volume, le titre à nouveau signalé pour la
commodité de nos bibliothèques, s'égrenant presque tout entier lettre par
lettre (le et seulement y
échappe : deux lettres intercalées, en bistre), au dessus de la raison
sociale de l'éditeur, lequel réserve ce seul endroit pour signer son travail
— dont nous saluons une fois pour toutes l'inspiration,
l'intelligence et le soin. Et puis, en quatrième de couverture, non pas un
texte de présentation mais, commentaire plus suggestif, le détail d'une photo
de montagne, détaché et monté en bandeau vertical de manière à représenter en
abîme, selon un champ d'une grande profondeur, le couple d'un photographe fort
affairé à son lourd appareillage (trépied, chambre photographique, voile noir…)
et d'une femme vêtue à l'ancienne, de pied en cap, le bâton d'alpiniste à la
main et le visage tourné vers l'autre photographe, celui qui prend la scène
— ce bandeau libérant sur sa droite assez de blanc et en tout cas
bien plus qu'il n'en fallait pour satisfaire, tout au bas de la page, à
l'obligation légale et commerciale de certain code à barres.
Et maintenant, ayant déjà noté en pensée le mot et l'impression
irrésistible d'un beau livre, plongeons dans l'épaisseur de ce volume.
Images de l'alpinisme
Avant que le lecteur n'ait démêlé, dans leur profusion,
l'existence en effet et l'ordre de certaines séries, les photos de ce livre,
signées ou anonymes, professionnelles ou non, lui manifestent ensemble et très
diversement la gloire de la montagne et celle de la photographie au moment de
leur âge classique, la gloire des grimpeurs et photographes connus et inconnus,
mais aussi celle de l'édition et de l'imprimerie dans le nôtre.
Toutes les sépias et tous les supports des tirages
photographiques ; toutes les profondeurs de champ, toutes les contraintes
envisageables et tous les angles possibles (ils ne sont pas en si grand
nombre) : la montagne proposait aux photographes des défis techniques hors
de l'ordinaire, des sujets vertigineux et des personnages hors normes (humains
surhumains, ou trop humains), à montrer en leurs gestes, à portraiturer, et même
assez souvent à ironiser.
Dans ce livre, nous voyons probablement tous les marrons du
marron, tous les gris du gris, tous les noirs du noir, tous les blancs, toutes
les densités des masses que nos presses savent distinguer, et bien plus sans
doute que nos logiciels ne peuvent encore en numériser (la photogravure, elle,
abouche l'image à l'objet). Toutes ces formes violentes et ces volumes
bizarres, toutes ces matières de la haute montagne en tous leurs états :
ces grains des choses, ces consistances, ces faillages et ces soufflures ;
toutes ces ombres et ces lumières, tous les genres d'obstacles qui projettent
les unes par la force indéfiniment variée et modelée des autres ; toutes
ces circonstances atmosphériques ! Toutes les déclinaisons et modalités de
ces substances qui règnent en haute altitude : rochers, glaces, neiges,
air et nuages, mais aussi corps humains, masculins et féminins, avec leurs
attributs de cordes, échelles et bâtons, et jusqu'aux cuirs des brodequins, aux
velours des pantalons, aux feutres des chapeaux et aux textures de la cigarette
insolente que Georges Livanos vient d'allumer en plein relais (p. 241,
cette cigarette qui, sans le vouloir, offense au passage nos préjugés
d'époque)… Ici la photo a enregistré l'infinie variété de la montagne et les
modalités de la présence humaine quand celle-ci ose s'y employer, et
l'artisanat du livre a porté, lui, très loin sa capacité industrieuse à
reproduire l'application mécanique et chimique de la photographie au réel.
Toute l'histoire de l'alpinisme à son moment critique, de ses
costumes, de ses techniques et appareillages, de son idéologie. Toute la gamme
des problèmes pratiques à résoudre en haute montagne et de leurs
transformations au gré des progrès des métaux, textiles ou cordages, et celle
des postures et attitudes possibles, les unes et les autres formalisées jusqu'à
la démonstration. D'où ces groupes en ascension ou en marche dans des paysages
bouleversants, et leur imposant leur ordre ; ces ordonnancements
schématiques et conceptuels de figures humaines ; ces ballets à un, à deux
ou à trois personnages, qui proposent telles figures de la montée ou de la
descente à travers telles situations et telles solutions ; et cette
élégance, jusque dans les photos maladroites ou manquées, que produit
l'adéquation du geste entre la fin et les moyens, dans l'ordre de la
photographie comme dans l'ordre des choses. Dans nombre de ces images, et pas
seulement dans celles qui représentent l'alpinisme acrobatique apparu à partir
des années 1880, « les alpinistes déroulent […] une chorégraphie où l'on
voit les membres de la cordée dans une attitude qui vaut pour tout grimpeur au
même endroit : la difficulté du pas et surtout sa morphologie
— dalle, fissure, surplomb… —, reliées aux techniques
d'escalade utilisées — adhérence, opposition, coincements divers,
escalade artificielle… — pour franchir ce type de difficultés
modèlent la posture de l'alpiniste en cet endroit » (Philippe Poncet,
« L'alpiniste photographié », p. 76). Ces analyses posées des
groupes, ces catalogues raisonnés des attitudes appelées par tel ou tel
problème, ce graphisme étudié des personnages enlevés sur les lumières
violentes des glaciers, tout cela évoque en effet immanquablement la beauté des
scènes où l'on danse.
Je n'en veux pour preuves que les photos des pages 82 à 103 et aussi les
innombrables photos d'escalades en rocher et en glace, qui aboutissent aux
espèces de figures, très différentes entre elles, du grimpeur anonyme de la
page 242 et de Rébuffat dans le Piz Badile (p. 243). Figures légères,
ombres chinoises, funambulisme,
ici le plus souvent éclatent la beauté, volontaire ou involontaire, la
sublimation de l'effort et de la souffrance, une sorte de facilité dans la
difficulté, lesquelles ne règnent décidément que dans les œuvres de l'art.

Anonyme sur le glacier des Bossons, tirage sur papier albuminé, vers 1900
Alpinisme et photographie, p. 89
© Les Éditions de l'Amateur
Entre bien d'autres, il faudrait commenter en détail la
chorégraphie de la page 89 : de gauche à droite, trois hommes à canotiers,
l'un se préparant de profil à franchir une sorte de brève faille, l'autre
enjambant une crevasse, de face et de toute son enfourchure, et le troisième, à
nouveau de profil, et engagé dans l'ascension d'un sérac. Trois positions,
trois gestes et trois regards, trois utilisations et trois directions du
bâton ; et l'élégance de toute la scène concentrée sur la figure centrale
que sa posture, son costume complet, sa cravate et sa chaîne de montre
rapporteraient tout aussi bien au tableau d'une gondole sur une lagune un tant
soit peu mouvementée ou encore à l'un des plateaux d'une comédie
musicale : il va chanter.
« L'homme précaire et la photographie »
Aussi quand nous entrons dans l'essai de Pierre-Henry Frangne, à
la page 45, sommes-nous surpris, décontenancé puis carrément arrêté, et pour un
long moment. Non pas par le triple exergue — trois paroles :
d'un guide, d'un alpiniste illustre et d'un poète, qui posent d'emblée à la
réflexion des dimensions vastes et des sollicitations fortes —, ni
non plus par l'avertissement, repris de Jean-Marie Schaeffer, à l'égard de
celui qui ouvre un livre de photographies comme de celui qui entend en écrire,
mais par la manière dont l'auteur aborde ces photographies, dans ce livre que
déjà nous venons de feuilleter : par l'affirmation selon laquelle
celles-ci « ne sont pas faites pour être [belles et sublimes] puisqu'elles
sont des documents ou des images-souvenirs ; puisqu'elles sont les
empreintes, les traces ou les témoignages d'un moment, d'un geste, d'un
événement constitutifs d'une course en haute montagne ».
Qu'est-ce qui est beau dans ces images qui ne sont pas des
œuvres d'art et qui possèdent cependant une puissance d'évocation même pour
ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de la sauvagerie de la montagne
[…] ? Qu'est-ce qui est beau dans ces photos qui échappent aux genres de
la peinture classique, qui ne sont ni de purs paysages composés comme des
tableaux où la grandeur de la nature serait le motif principal, ni de purs
portraits où émergerait, solitaire, le visage expressif de l'homme […] ?
Qu'est-ce qui est beau dans toutes ces ambivalences ou ces ambiguïtés :
les photographies elles-mêmes, ou la réalité dont elles sont les traces
légères ? La représentation ou son objet ? La vue, ou ce sur quoi
elle porte ? (p. 46)
Or, regardant ces photos, justement nous aurions juré qu'elles
dépassent, et d'origine, la photo-souvenir et le document, qu'elles ont un prix
par elles-mêmes, qu'elles sont des œuvres de l'art et même que la plupart se
veulent comme telles ou, en tout cas construites et réfléchies, que, d'autre
part, leur réunion et leur disposition en ce livre, à elles seules, leur
conféreraient ce caractère d'œuvres et que, enfin et à la limite, cette
question de la distinction de valeur esthétique entre la photographie et son
objet pourrait se poser à propos de toute photo représentant tout objet. Assez
vite, nous comprendrons que ces questions servent ici à Pierre-Henry Frangne à
repérer un problème historique, à créer les distinctions nécessaires à son
propos, à invoquer les références de pensée indispensables, bref à construire
l'édifice impressionnant des dépassements que nous allons examiner tout à
l'heure.
Mais une espèce d'inquiétude demeurera encore sur la raison profonde qui lui
fait dénier à ces images leur caractère d'œuvres, et il nous faudra plus de
temps pour entrevoir — pour supposer, à nos risques et périls —
l'expérience qui pourrait bien commander et cette dénégation et ce détour, et
la nature de ce qui distinguerait la montagne de toute image de la montagne,
artistique ou non, et peut-être ce qui distinguerait l'expérience de la
montagne de toute autre expérience, — et, finalement, ce qui
distinguerait fondamentalement toute expérience de sa représentation, quelle
qu'elle soit.
La périodisation (1860-1940) que déterminent le volume tout
entier et, en son sein, l'essai de Pierre-Henry Frangne, tend à mettre en
évidence une révolution qui se déroule à la fois dans la considération de la
montagne, dans la photographie et dans toute l'esthétique, dans la philosophie
elle-même : telle est l'assise historique, solide et indubitable du titre
et de la pensée dans cet ouvrage. La première référence invoquée est celle de
Michel Foucault, en un passage où celui-ci décèle, dans les années 1860-1880,
l'époque d'une passion des images.
Mais toutes, qu'elles soient de Théophile Gautier, de Baudelaire, de Nadar ou
de sir Leslie Stephen, ou de Foucault, toutes soulignent en cet âge le moment
de quatre « premières fois » :
Première fois de la vision d'une nouvelle réalité jusque là
inconnue (celle de la haute montagne), première fois d'une nouvelle activité où
l'homme engage une inédite conception de son corps et du rapport de son corps
au réel (l'alpinisme), première fois d'une nouvelle image de cette nouvelle
réalité et de cette nouvelle activité (la photographie), première fois enfin
d'une nouvelle modalité de cette image : la photographie instantanée,
prise sur le vif, capable comme jamais
auparavant de capturer d'un coup, d'une part l'immobilité de la montagne […]
et, d'autre part, la fugacité, le mouvement du geste de l'alpiniste accroché à
elle […]. (pp. 47-48)
Voilà fondée solidement et distinctement la nouveauté absolue
d'un mouvement en effet inattendu et fascinant, où se lient curieusement les
destins de l'alpinisme et de la photographie
et dont l'auteur va éclairer les implications techniques et scientifiques, mais
surtout philosophiques, esthétiques et éthiques, implications qui assigneront
au couple de la photographie et de l'alpinisme une signification majeure dans
l'histoire récente de la pensée, et qui seront toutes renversantes.
Dans le domaine de la science et des techniques et sous
l'invocation principale d'Heidegger, les « Temps Modernes » sont ici
analysés comme « la première époque par laquelle le monde n'existerait et
ne serait disponible pour l'homme qu'en tant que ce dernier détient le pouvoir
réfléchi, critique et contrôlé, de le transformer en images » (p. 48).
Dans cette révolution « un sujet-spectateur s'empare d'un monde-image par
des moyens scientifiques, techniques, industriels et artistiques que les hommes
du XIXe siècle ont immédiatement compris » (p. 49). Ainsi,
en quelques années, l'humanité s'est-elle procuré, sous le format portatif
d'images indéfiniment classables et interrogeables, les formules de la Terre et
les modes de la présence que les hommes y entretiennent, cela en général et
ici, particulièrement et de manière significative, les enregistrements de l'un
de ces milieux étrangers où ils se sont à cette époque aventurés.
(Probablement les analyses et les conclusions de Pierre-Henry Frangne
vaudraient-elles aussi pour les photos et les films, sensiblement plus tardifs,
des déserts, de la mer et des grands fonds.)
D'autre part, et encore plus fondamentalement, on ne peut
réintégrer la beauté moderne — dont la photographie est l'une des
expression les plus provocantes — dans la sphère de l'esthétique et
dans celle de l'éthique qu'au prix d'un travail de retournement dans les
notions du beau, du sublime et de la liberté. Parce que la photo d'alpinisme
expose les choses nues à la seule matérialité d'une surface sensible à
l'impression de la seule lumière réelle et parce qu'elle expose l'homme à même
les choses et sans autre recours que lui-même, que ses cordes et pitons et que
ses appareils de prises de vues, il faut bien que la liberté reçoive une
définition autre que métaphysique, que le sublime soit réintégré dans
l'immanence d'une expérience rigoureusement humaine du dépassement de soi, que
la beauté ne fasse plus que couronner la réalité des choses et du geste humain
pris en leur présence. Évidemment cette époque ne marque pas seulement la
rencontre quasiment miraculeuse de l'alpinisme et de la photographie en leur
histoire à l'un et à l'autre : elle est aussi le tout dernier moment
révolutionnaire de l'esprit humain, dont les noms emblématiques sont
principalement ceux de Nietzsche, de Sartre et de Mallarmé (secondairement,
entre autres, ceux de Burke et de Stephen, de Benjamin et de Barthes) et dont
les expressions décisives et presque toujours privatives sont celles d'art sans
art,
de sublime sans transcendance ni même de transcendantal, de beauté sans
répondant idéal ni modèle rhétorique, de la vie morale entendue comme
« cet effort en quoi consiste la situation de l'homme cherchant
l'impossible et définitive synthèse de l'en-soi et du pour-soi, cette puissance
et cette précarité où se détachent et s'embrouillent inextricablement l'homme
et les choses, le sujet et l'objet, la liberté et la nécessité »
(p. 54).
Le sublime photographique consisterait alors, non en un accès
à l'ordre transcendant de la spiritualité par-dessus une réalité sensible
immaîtrisable complètement, mais en la monstration d'expériences sensibles et
affectives qui choquent nos modes
habituels de perception du monde et qu leur font violence alors même que c'est
la réalité qui est enregistrée et qui est ainsi montée comme le lieu d'une
infinité d'expériences possibles. […] L'image photographique est sublime à
condition qu'elle produise le sentiment d'irréalité de la réalité même.
(p. 62)
On voit mieux, dès lors, ce que Pierre-Henry Frangne entendait
faire en posant d'emblée le caractère non artistique de ces photos, c'était de
commencer à les porter dans la zone d'une nouvelle frontière de l'art :
Fragments de fragments, ces séries foncièrement ouvertes de
photographies documentaires sont cependant des œuvres d'art parce que désormais
les œuvres d'art « en tant que photographies » comme dit Benjamin, nous livrent une beauté moderne,
c'est-à-dire une beauté qui ne fuit pas les désordres du monde matériel, qui ne
les transfigure pas par la grâce d'un style, qui ne les embellit pas non plus
par les moyens d'une composition organique ou par ceux de la nature harmonieuse
du symbole : un art sans art, un art qui contient en lui le non-art et
l'informe si l'on veut ; un art du choc fugitif et du temps, de
l'attention inattentive ou flottante, et qui est constitué « de vue et non
de visions ». (p. 59)
Ainsi, de même que ce livre n'appartient pas sans plus à la
catégorie commerciale et esthétique des « beaux livres », de même la
photographie d'alpinisme ici ne se réduit pas à celle de la photo d'art.
Le corps, sous tous les angles
Cependant ces passages mêmes de l'essai et d'autres, et
l'analyse finale consacrée à « l'énigme du corps » et à la
« sagesse de l'effort » pointent vers autre chose, qui concerne
l'alpinisme et plus vraiment la photographie. ň ce moment-là, en effet, la
citation du récit que fait Leslie Stephen de son ascension et la question
qu'il pose (« Où finit le mont Blanc et où est-ce que je
commence ? ») n'évoquent plus exactement la relation entre la photo et
l'alpinisme mais la question « d'un moi qui, dans l'effort, sent sa
distance et sa continuité par rapport au réel matériel ou corporel […] la
question de notre corps » (p. 64). Plus loin (p. 68), une
citation de Michel Serres précisera cette question en lui donnant le contexte
de la relation du moi aux autres alpinistes, dans la difficulté d'une
ascension : « Saisie par la neige, écrasée de soleil, courbée face au
vent, réduite au silence par le souffle court, la cordée s'élève donc dans la
paroi. Sans attendre, la pesanteur s'y venge du moindre faux pas. […] Cette
rudesse loyale apprend la vérité des choses, des autres et de soi, sans
faux-semblant. »

George Perry Ashley Abraham, traversée Charmoz-Grépon, épreuve gélatino-argentique, 1898
Alpinisme et photographie, p. 138
© Les Éditions de l'Amateur
Dans ce volume, l'essai de Michel Jullien, « L'homme de
dos », évoquait lui aussi le corps de l'alpiniste : ses postures, sa
relation au vide et au plein, les positions du photographe dans la cordée et
les angles qu'il peut prendre au péril de sa vie et de celle de ses compagnons.
En grimpeur lui-même et sous l'angle de la technique de l'escalade, il
analysait les gestes et leurs significations telles qu'elles s'inscrivent dans
un processus d'ascension, les rares expressions du visage, les facteurs du
risque, les déterminations réciproques des prises du grimpeur engagé dans les
parois et de la prise de vue :
Il s'établit un partage entre la précarité du photographié et
celle du photographe, entre le geste souvent grotesque, baroque, inesthétique
d'une part, et l'imperfection qualitative du cliché (flou, défaut de
cadrage…) d'autre part. Ce type de documents porte la trace d'une improvisation
partagée : improvisation gestuelle répétée des acteurs, improvisation
d'une prise photographique au cours de l'ascension. […] il faut beaucoup
d'heures pour que se passe une escalade, mais la durée du déclic, infime, nous
ramène en imagination au peu de temps que suppose un accident. Ces clichés
apparaissent comme autant de chutes contenues, réprimées. […] En insistant sur
le développé de l'action, sur le risque en cours, ces prises de vue nous
fondent dans la cordée. (« L'homme de dos », pp. 36-37)
Or, à la fin de l'essai de Pierre-Henry Frangne, il n'est plus
guère question de la photographie, mais de l'expérience physique de l'alpinisme.
Et l'on saisit mieux ce qui fait que, parmi les photos du livre qui évoquent
l'escalade, l'auteur a choisi de commenter plutôt celles qui montrent l'effort
et même la souffrance ou bien que, comparant des portraits, il valorise les
photos de plein vent :
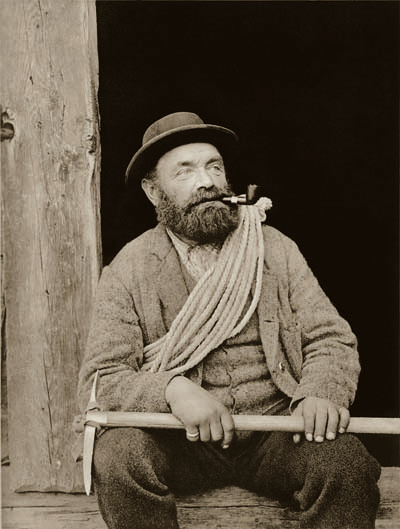
Alexandre Burgener, S. Kuntz, d'après cliché Wehrli, Les Alpinistes célèbres, 1956
Alpinisme et photographie, p. 126
© Les Éditions de l'Amateur

L. Devies(?), Giusto Gervasutti, fin années 30, S. Kuntz, d'après cliché Wehrli, Les Alpinistes célèbres, 1956
Alpinisme et photographie, p. 187
© Les Éditions de l'Amateur
Regardons, en effet, les hommes parvenus au sommet.
Contemplons surtout les deux admirables portraits de Luigi Comici et de Giusto
Gervasutti (pp. 186-187). Comparons-les d'abord aux portraits de guides pris
dans la vallée, celui de Jean Charlet et, surtout, celui d'Alexandre Burgener
(p. 126) […]. En bas le portrait est posé. La photographie mime la
(mauvaise) peinture et fixe les individus en continuelle, artificielle et
conventionnelle représentation. Les attributs du guide, la pipe, le chapeau, le
piolet et la corde manifestent ostensiblement ou théâtralement, l'essence d'un
métier désirant maladroitement se montrer sub specie aeternitatis. (p. 54)
Sans doute y a-t-il de cela. Mais l'attitude des deux guides
italiens ne manque pas non plus de théâtralité et la photo précédente (p. 185),
prise en pleine pente, manifeste ouvertement les mêmes attributs, comme tels,
et même une espèce d'attitude bravache qui ne paraît pas pourtant disqualifier
la photographie elle-même.
S'il y a ici du trouble ou du tremblé et des difficultés à
penser, ils viennent d'ailleurs que du sein de l'esthétique ou d'une insuffisance
de la pensée, et c'est la dimension la plus précieuse de cet essai. Dans Pierre-Henry
Frangne, ce qui résiste à l'image de l'album photographique et au préjugé de la
photogénie de la montagne, ce qui inspire et soutient sa réflexion dans les
synthèses fortes et audacieuses dont nous avons essayé de donner une idée,
c'est précisément ce qui résiste à toute photographie, dans la montagne et dans
l'alpiniste : c'est l'expérience éprouvée de la réalité inhumaine des
choses poussée ici à ses extrémités et de la précarité du moi, elle aussi
exaltée en cette expérience — de la précarité de chacun et assumée
par tous, grimpeurs et photographes —, exaltée au point où elle
devient dans le moi un autre mur de rocher et de glace.
Reprenant à son compte certaine formule de Spinoza
(« Personne n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps »),
Pierre-Henry Frangne écrit à un moment :
Qu'est-ce que
peut le corps ? Jusqu'où peut aller l'effort humain ? Jusqu'à quelle
hauteur un homme peut-il monter ? Par quelles voies et dans quelles
conditions peut-il accéder à un sommet ? En combien de temps ?
Jusqu'où peut-il souffrir pour surmonter les obstacles que la montagne lui
oppose ? (p. 65)
Voilà des questions que nulle photographie ne saurait poser par
elle-même, et elle saurait encore moins y répondre. Seul se les formule, pour
lui-même et dans leur dimension la plus générale, un moi qui, se confondant à
un moment donné avec son seul corps et cherchant à distinguer physiquement ce
corps-là de la masse rocheuse, avec d'autres corps tente de sortir par le haut
et de la paroi et de la question.
Néanmoins… Chaque photo de montagne — elles existent
réellement, à leur tour, certes plutôt muettes et laissant peu à dire (J.-M.
Schaeffer a raison), et objectives, et étranges, plutôt bonnes à feuilleter
qu'ouvertes à la contemplation —, chacune de ces photos
— y compris celles des danses sur les séracs ou des guides Jean
Charlet et Burgener —, chacune est comme l'une de ces maximes de La
Rochefoucauld inégales par principe et tellement rebelles aux enchaînements de
discours et au livre : sans ciller elle a fixé, brièvement (de plus en
plus bref, le temps de pose), la réalité des choses et de l'homme tel qu'il est
en butte aux choses ; elle brille, elle cède la place à une autre (« Fugacité »,
p. 69) ; elle nous donne à voir ce que nous ne saurions envisager en
face. Car, si les attributs de l'alpiniste qui figurent dans les portraits des
deux guides italiens ont en effet plus de nécessité que dans ceux de Burgener
ou de Whymper, sans ces attributs et sans la légende qui leur donne leur nom,
on ne saurait pas sans doute que de ces deux corps-ci l'un a mené mille courses
au péril de lui-même et de ses clients et que l'autre a donné son nom à des
sommets et vaincu le Cervin à grandes pertes dans ses compagnons.
Ainsi, en vertu du lien immédiat que la brûlure de la lumière
établit entre les pièges chimiques de notre fabrication et la réalité
inentamable des choses et des êtres, ces photos renouent par-dessus des siècles
avec le pouvoir magique des images telles qu'elles furent inscrites aux
grimoires ou aux rochers des cavernes. Nouvelles proses du monde, nos albums
certes documentent et classent des connaissances, mais aussi, poétiquement, ils
nous rappellent, nous lecteur, au trop peu de réalité que nous opposons à tout
ce qui est, hommes et choses et aussi bien, finalement, à nous-même. Cependant,
même si l'alpinisme et la photographie sont nés ensemble, la montagne n'était
pas, par quelque photogénie naturelle, liée d'avance à ces images ; il y
fallait l'invention et le soin de tous : industriels, photographes
professionnels ou d'occasion, éditeurs, essayistes.
Cela n'est pas rien quand même pour des photos, comme pour la
littérature, que de défier la solidité massive des choses et la précarité de
l'homme au regard de celles-ci. Mais, en effet, pour qui les regarde, le prix
de chacune s'évalue finalement à l'aune de l'expérience du monde et de
soi-même.
Pierre Campion
 Pierre-Henry Frangne, Michel Jullien,
Philippe Poncet, Alpinisme et photographie 1860-1940, Paris, Les Éditions de l'Amateur, 2006.
Pierre-Henry Frangne, Michel Jullien,
Philippe Poncet, Alpinisme et photographie 1860-1940, Paris, Les Éditions de l'Amateur, 2006.